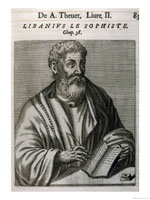Libanios (314-393)
Rhéteur
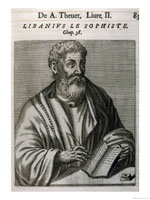
Né à Antioche [1] de Syrie, métropole de l’Orient pendant l’Antiquité tardive. Il est issu d’une famille curiale [2] plutôt appauvrie. Il perd son père vers l’âge de 11 ans et devient orphelin. Sa mère et ses 2 oncles Panolbios et Phasganiois veillent sur sa jeunesse studieuse.
À l’âge de 14 ans, il décide de vouer sa vie à l’étude et à la pratique de la littérature et de l’art oratoire. Rejetant l’enseignement de Zenobios d’Elusa auquel il devait succéder comme sophiste [3] d’Antioche après 354 parce qu’il le trouve de piètre qualité, il suit un parcours d’études atypique en se formant par lui-même tout en continuant de travailler chez un bon grammairien [4] qui pourrait être Didymos, puis va étudier à Athènes [5] entre 336 et 340.
En 340, Nicoklès, un grammatiste de Sparte [6], lui offre un poste de professeur à Constantinople [7], mais il manque l’occasion d’obtenir ce poste et doit s’installer à son compte. Professeur libre, il est entretenu uniquement par ses élèves jusqu’au nombre de 80. Mais grâce à sa renommée grandissante, l’empereur décide de le garder à Constantinople par une nomination à un titre surnuméraire. Seulement ses rivaux profitent des émeutes entre ariens [8] et de la répression de 342 pour le chasser de la ville.
Après un bref passage par Nicée [9], Libanios se réfugie alors à Nicomédie [10], de l’autre côté des détroits, où il devient un personnage célèbre par son art de la rhétorique. C’est une période heureuse pour lui et très productive. C’est à cette même époque qu’il aurait pu avoir dans son auditoire Basile de Césarée et que le futur empereur Julien se fit passer clandestinement ses cours.
Rappelé à Constantinople par l’empereur Constance II vers 347/348, il s’y déplait et finit par rentrer dans sa ville natale d’Antioche en 354, d’où il ne semble guère avoir bougé jusqu’à sa mort.
Peu après son retour, il prend une concubine d’origine servile avec laquelle, il aura un fils Arabios rebaptisé Cimon. Il se fait rapidement une grande réputation de rhéteur [11] dans la ville. De plus, il développe de très bons contacts avec les dirigeants municipaux et aussi avec les fonctionnaires de la cour de l’empereur Constance II.
L’empereur suivant Julien, pour préparer une expédition contre la Perse, installe un temps son palais à Antioche. Mais à cause de son paganisme affiché et de sa rigueur morale il entre en conflit avec la population de la ville. Ce qui n’est pas pour déplaire à Libanios qui entretiendra avec ce dernier une relation amicale. Seulement la mort de l’empereur à la suite de la Bataille de Ctesiphon [12] en 363, aura la double conséquence d’affecter personnellement Libianos et d’éloigner pour toujours l’idée d’un retour à l’empire païen d’Auguste, Trajan et Marc Aurèle. C’est vers cette époque qu’il dut avoir pour élève le futur évêque Amphiloque d’Iconium et les auteurs chrétiens ultérieurs lui ajoutent Jean Chrysostome vers cette époque.
L’époque qui suit la mort de Julien, est plus difficile pour Libanios. La tentative de Coup d’État mené par Procope contre le nouvel empereur Valens vers 365 à laquelle bon nombre de cités de Syrie [13] se sont associées et surtout la conspiration menée par Théodore d’Antioche alors que Valens venait d’y établir sa capitale dans la cadre d’opérations militaires en 371/372 ont entraîné des représailles sévères à l’égard des cités d’orient et la persécution de beaucoup d’intellectuels païens.
Même si en raison de l’influence qu’il conserva à la cour, il ne fut pas directement touché par les persécutions, cette affaire le marqua, bien que ses écrits ne manifestent pas d’hostilité particulière à l’égard de cet empereur.
Après la catastrophe de la bataille d’Andrinople [14] et la mort de Valens en 378, Libanios pu de nouveau obtenir les faveurs de la cour de Théodose 1er. Il interpelle ce dernier en faveur des sanctuaires paiens et pour lui dénoncer divers abus des puissants. Vers 383/384, il reçoit le titre de questeur honoraire. La date de sa mort reste l’objet de discussion ; sans doute entre 393 et 394.
Pour Libanios l’éloquence rhétorique n’est pas qu’une profession où il veut exceller, c’est un art de vivre, un élément fondamental de l’homme bien fait. En cela, il s’inscrit dans la tradition isocratique, cette tradition pédagogique de la rhétorique où "L’art oratoire apprend à bien penser, à bien agir en même temps qu’à bien écrire." - Isocrate. De la même manière, on peut aussi y trouver les racines de sa pensée réactionnaire et de son "nationalisme" hellénique
Conscient de l’évolution de son siècle, il combat tous les adversaires à ses yeux de la culture grecque et de ses traditions païennes comme les empereurs Constantin et surtout Constance II, auteur d’une politique de répression contre le paganisme et soutient les hommes favorables à la réaction païenne tel l’empereur Julien
Il combat aussi l’évolution centralisatrice du pouvoir et l’interventionnisme croissant des empereurs dans la cité.
Notes
[1] Antioche est une ville de Turquie proche de la frontière syrienne. Elle est située au bord du fleuve Oronte. Antioche était la ville de départ de la route de la soie.
[2] Dans la Rome antique, le mot curia (curie en français), désigne un groupe d’hommes, ou le lieu où ils se réunissent. Le terme désignait ainsi des subdivisions civiques à Rome à l’époque de la monarchie et dans les cités de droit latin. À Rome, la Curie désigne le bâtiment où se réunissait le Sénat romain.
[3] Un sophiste désigne à l’origine un orateur et un professeur d’éloquence de la Grèce antique, dont la culture et la maîtrise du discours en font un personnage prestigieux dès le 5ème siècle av. jc en particulier dans le contexte de la démocratie athénienne, et contre lequel la philosophie va en partie se développer. La sophistique désigne par ailleurs à la fois le mouvement de pensée issu des sophistes de l’époque de Socrate, mais aussi le développement de la réflexion et de l’enseignement rhétorique, en principe à partir du 4ème siècle av. jc, en pratique à partir du 2ème siècle ap. jc. dans l’Empire romain.
[4] Le grammaticus, souvent traduit par « grammairien » en français, est, dans l’Antiquité à l’époque hellénistique et romaine, l’enseignant qui instruit les adolescents entre 11 ou 12 ans et 15 ou 16 ans. Il prend les élèves à la suite du ludi magister, litterator, chargé de l’enseignement primaire ; après leur scolarité auprès du grammaticus, les jeunes suivent les cours des rhéteurs. Le rôle du grammaticus est principalement de faire connaître la littérature, en particulier les grands poètes épiques : Homère et Virgile, et de développer la maîtrise de la langue.
[5] Athènes est l’une des plus anciennes villes au monde, avec une présence humaine attestée dès le Néolithique. Fondée vers 800 av. jc autour de la colline de l’Acropole par le héros Thésée, selon la légende, la cité domine la Grèce au cours du 1er millénaire av. jc. Elle connaît son âge d’or au 5ème siècle av. jc, sous la domination du stratège Périclès
[6] Sparte était une ville-état de premier plan dans la Grèce antique . Dans l’Antiquité, la ville-état était connue sous le nom de Lacedaemon, tandis que le nom de Sparte désignait son établissement principal sur les rives de la rivière Eurotas en Laconie, dans le sud-est du Péloponnèse. Vers 650 av. jc, elle est devenu la puissance terrestre militaire dominante dans la Grèce antique. Compte tenu de sa prééminence militaire, Sparte fut reconnu comme le chef de file des forces grecques combinées pendant les guerres gréco-perses. Entre 431 et 404 av. jc, Sparte fut le principal ennemi d’ Athènes pendant la guerre du Péloponnèse
[7] Constantinople est l’appellation ancienne et historique de l’actuelle ville d’Istanbul en Turquie (du 11 mai 330 au 28 mars 1930). Son nom originel, Byzance, n’était plus en usage à l’époque de l’Empire, mais a été repris depuis le 16ème siècle par les historiens modernes.
[8] L’arianisme est un courant de pensée théologique des débuts du christianisme, due à Arius, théologien alexandrin au début du 4ème siècle. La pensée de l’arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d’abord humain, mais un humain disposant d’une part de divinité. Le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejeta l’arianisme. Il fut dès lors qualifié d’hérésie par les chrétiens trinitaires, mais les controverses sur la double nature, divine et humaine, du Christ (Dieu fait homme), se prolongèrent pendant plus d’un demi-siècle. Les empereurs succédant à Constantin revinrent à l’arianisme et c’est à cette foi que se convertirent la plupart des peuples germaniques qui rejoignirent l’empire en tant que peuples fédérés. Les wisigoths d’Hispanie restèrent ariens jusqu’à la fin du 6ème siècle et les Lombards jusqu’à la moitié du 7ème siècle.] et nicéens[[Le 1er concile œcuménique se réunit à Nicée en 325 pour statuer au sujet de l’arianisme. Les principales personnalités engagées dans ce débat étaient présentes, dont Arius, Eusèbe de Nicomédie qui lui était favorable, Eusèbe de Césarée, modéré, Alexandre d’Alexandrie (accompagné d’Athanase d’Alexandrie comme secrétaire) qui s’opposait à lui, de même que, de façon intransigeante, Eustathe d’Antioche et Marcel d’Ancyre. Une quasi unanimité s’est prononcée pour condamner les thèses ariennes et rédiger un symbole affirmant que le Fils est consubstantiel (homoousios) au Père, c’est-à-dire de même nature que lui.
[9] İznik (anciennement Nicée) est une ville d’Anatolie (Turquie) connue surtout pour deux conciles du début de l’histoire de l’Église chrétienne. Elle fut aussi au Moyen Âge la capitale de l’empire de Nicée, vestige de l’empire byzantin pendant les croisades.
[10] Nicomédie est une ville d’Asie mineure, capitale du royaume de Bithynie. Elle est appelée Izmit aujourd’hui. Hannibal s’y donna la mort en 183 av. jc et l’historien Arrien y naquit vers 90.
[11] la rhétorique est d’abord l’art de l’éloquence. Elle a d’abord concerné la communication orale. La rhétorique traditionnelle comportait cinq parties : l’inventio (invention ; art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre), la dispositio (disposition ; art d’exposer des arguments de manière ordonnée et efficace), l’elocutio (élocution ; art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments → style), l’actio (diction, gestes de l’orateur, etc.) et la memoria (procédés pour mémoriser le discours).
[12] La bataille de Ctesiphon a eu lieu le 29 mai 363 entre les armées de l’empereur romain Julien et l’empereur Sassanide Shapur II de Perse à l’extérieur des remparts de la capitale perse Ctesiphon. L’issue de la bataille est une victoire peu concluante des Romains puisque l’empereur Julien meurt peu après et que les forces romaines sont trop éloignées de leur ligne de ravitaillement pour continuer leur campagne.
[13] La Syrie fut occupée successivement par les Cananéens, les Phéniciens, les Hébreux, les Araméens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Arméniens, les Romains, les Nabatéens, les Byzantins, les Arabes, et partiellement par les Croisés, par les Turcs Ottomans et enfin par les Français à qui la SDN confia un protectorat provisoire pour mettre en place, ainsi qu’au Liban, les conditions d’une future indépendance politique.
[14] La bataille d’Andrinople ou d’Adrianople (aujourd’hui Edirne en Turquie européenne) a eu lieu le 9 août 378. Elle désigne l’affrontement entre l’armée romaine, commandée par l’empereur romain Valens et certaines tribus germaniques, principalement des Wisigoths (Goths Thervingues), et des Ostrogoths (Goths Greuthungues), commandées par Fritigern. Il s’agit d’un des plus grands désastres militaires romains du ive siècle, comparable à la défaite de Cannes. Cette bataille ne résulte pas d’une invasion, mais d’une mutinerie des fédérés Goths établis dans l’Empire romain.