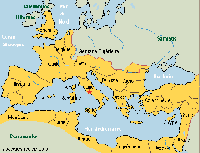 Membre de l’ordre équestre [1], il a été notamment préfet du prétoire [2] de Marc-Aurèle puis de Commode, couronnement d’une carrière de chevalier, classique mais brillante. Il meurt victime du contexte troublé de la cour impériale au début du règne de Commode.
Membre de l’ordre équestre [1], il a été notamment préfet du prétoire [2] de Marc-Aurèle puis de Commode, couronnement d’une carrière de chevalier, classique mais brillante. Il meurt victime du contexte troublé de la cour impériale au début du règne de Commode.
Paternus est essentiellement connu par les sources littéraires. La plus complète est l’ouvrage du sénateur et historien de langue grecqueCassius Dion ou Dion Cassius. Contemporain des faits, généralement bien informé, Cassius Dion tient Paternus en haute estime du fait de sa carrière et de la confiance que lui accordait Marc Aurèle, lui-même admiré par l’historien. Il est également évoqué chez Hérodien, un autre contemporain de langue grecque, mais de manière bien plus allusive. Il est par ailleurs évoqué par des sources plus tardives, comme l’écrivain militaire Végèce, mais surtout, “la Vita Commodi”, appartenant à la somme de L’Histoire Auguste [3], composées au 4ème siècle, par des auteurs mal connus, dont les récits sont parfois assez fantaisistes. Sa carrière est également renseignée par plusieurs inscriptions grecques et latines, notamment la tabula banasitana [4].
Probablement originaire de Rome, membre de l’ordre équestre, juriste de formation ses travaux sont cités dans le Digeste [5], auteur d’un ouvrage intitulé “De Re Militari” sur le droit et la tactique militaire, il devient secrétaire “ab epistulis latinis” [6] sous l’empereur Marc-Aurèle atour de 171. On peut raisonnablement supposer qu’il a suivi avant cette nomination une carrière équestre classique.
Il accompagne le quartier général de l’empereur au cours de sa première campagne contre les Germains [7] sur le Danube [8] de 169 à 175. Au cours de celle-ci, il est chargé d’une mission diplomatique auprès de la tribu des Cotini [9] afin d’obtenir leur alliance contre leurs voisins Marcomans [10]. L’échec de cette opération n’empêcha pas Marc Aurèle de lui conserver sa confiance.
Il devient en effet l’un de ses préfets du prétoire, à une date discutée au plus tôt en juillet 177, mais certainement avant 179. On le retrouve aux côtés de l’empereur au cours de la deuxième guerre germanique de 178 à 180 au cours de laquelle il s’illustre en remportant une victoire importante contre les Marcomans en 179, à l’issue de laquelle Marc-Aurèle obtint sa dixième salutation impériale. Une inscription de Rome, très lacunaire, laisse entendre qu’il aurait pu recevoir à cette occasion les ornements consulaires.
A la mort de Marc-Aurèle en 180, son fils et successeur Commode le maintient en fonction, avec un nouveau collègue, Tigidius Perennis. Paternus constituait en effet un élément de continuité avec le règne de Marc Aurèle, et bénéficiait en outre de soutiens au Sénat, ce qui dans ce contexte de succession impériale pouvait être un atout pour le prince. Il dut assister ce dernier au cours des négociations qu’il mena avec les Germains sur le Danube avant son retour à Rome le 22 octobre 180.
Le retour à Rome de Commode et de sa cour est marquée par une certaine instabilité. L’empereur doit ainsi déjouer et réprimer des conjurations dont certaines se nouent au sein même de la famille impériale.
Soupçonné de comploter avec Salvius Julianus auquel sa fille était promise. Il est d’abord nommé sénateur.
Après quoi, il fut éliminé en 182.
