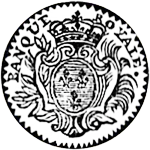 Né à Barneville [1], était le fils d’Adrien Dutot, charpentier de marine au Village du Tôt [2], dans la paroisse de Barneville, et d’une certaine Barbe Bessin, sans doute originaire de Cherbourg. Il est l’un des pères de l’étude quantitative des phénomènes économiques. il fut sous-trésorier de la Banque royale fusionnée en 1720 avec la compagnie des Indes, toutes deux institutions fondées par John Law sous la régence de Philippe d’Orléans. Il devint associé libre, le 3 décembre 1728, de la Société des Arts [3].
Né à Barneville [1], était le fils d’Adrien Dutot, charpentier de marine au Village du Tôt [2], dans la paroisse de Barneville, et d’une certaine Barbe Bessin, sans doute originaire de Cherbourg. Il est l’un des pères de l’étude quantitative des phénomènes économiques. il fut sous-trésorier de la Banque royale fusionnée en 1720 avec la compagnie des Indes, toutes deux institutions fondées par John Law sous la régence de Philippe d’Orléans. Il devint associé libre, le 3 décembre 1728, de la Société des Arts [3].
Nicolas Dutot, directeur de la Chambre de Justice de 1716, fut emprisonné à la Bastille du 29 avril au 8 septembre 1717. En effet, il semble avoir tenté de monnayer son influence afin de permettre à certains justiciables de voir diminuer leur taxe.
Il se rendit célèbre par ses Réflexions politiques sur les finances et le commerce, publiées d’abord sous forme de lettres en 1735, puis, à La Haye, sous la forme d’un ouvrage en deux volumes en 1738, visant en particulier à défendre le Système de Law. Ses théories économiques, prenant le contre-pied de l’usage français de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne, s’efforcent de montrer que le numéraire ne doit point se voir attribuer une valeur arbitraire que le souverain puisse modifier à son gré. Dutot pressent également, plusieurs années avant Montesquieu , l’influence des taux d’intérêt sur l’évolution de la masse monétaire.
Nicolas Dutot est mort à Paris au matin du 12 septembre 1741.
